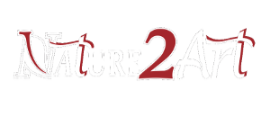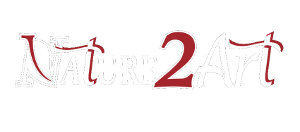L’église Saint George : origines, reconstruction et caractéristiques
L’église Saint George : origines, reconstruction et caractéristiques
Ce texte a été rédigé à partir « Rapport sur l’architecture, le mobilier, les verrières et l’orfèvrerie de l’église Saint George» de Ginette Laroche, Ph.D., historienne de l’art, daté du 6 juillet 2006, et de Yolande Allard, « Histoire de l’église Saint George (Drummondville) », septembre 2005.
L’église Saint George de Drummondville constitue un précieux témoin du patrimoine religieuxde de l’Église d’Angleterre au Québec. Fondée au XIXe siècle, cette église se distingue autant par son histoire de fondation et de reconstruction que par la richesse de ses vitraux, qui en ornent aujourd’hui la nef et les façades.
Depuis plusieurs années, c’est la Fondation de l’Église St. George inc. qui assure la gestion et la mise en valeur de ce site patrimonial, en partenariat avec la communauté locale et différents experts. Cet engagement est soutenu et encadré par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, un organisme provincial dédié à la conservation, à l’étude et à la valorisation du patrimoine religieux.
Ce partenariat contribue à préserver les éléments architecturaux et verriers d’exception, dont plusieurs œuvres de la nef sont signées par le maître verrier montréalais J.C. Spence. Explorons ensemble cette histoire unique, à travers les vitraux et les murs de pierre de Saint George faisant partie du patrimoine religieux québécois.
🏛️ Origines et contexte de construction (1822-1855)
L’Église Saint George et ses vitraux anciens commence en 1855, lorsqu’il devient évident que la première église, construite en 1822, ne répond plus aux besoins de la communauté. Le comité chargé du nouveau projet opte pour une vision résolument inspirée par les recommandations de la Society for Promoting Christian Knowledge et du 3ᵉ évêque anglican de Québec, George Jhéoshaphat Mountain. Ces préceptes, relayés dans le Canadian Ecclesiastical Gazette en 1851, prônent un retour aux modèles médiévaux, selon les principes des ecclésiologistes.
📜 Conformité au modèle ecclésiologiste, architecture anglicane
L’église de 1855 prend forme et suit rigoureusement les prescriptions architecturales sur un terrain donné par les héritiers de Frédéric George Heriot, près du cimetière paroissial:
- Plan : bâtiment rectangulaire, longueur triple de la largeur, chœur en saillie, chevet plat orienté au nord-est, avec entrée dans l’axe et vestiaire en annexe.

Plan de l’église St.George, architecture anglicane. - Intérieur : fonts baptismaux à l’arrière, allée centrale, bancs répartis symétriquement, chœur surélevé et clôturé.
- Style néogothique : construction en pierre, toit à pente raide, ouvertures ogivales, contreforts marquant l’ossature de la toiture.
Ces éléments visent à évoquer l’esprit des églises rurales médiévales, dans un langage architectural codifié.
🔥 Ajouts et reconstruction après l’incendie (1863–1884)
Un incendie en 1863 donne lieu à une reconstruction en 1866. Cette phase permet d’ajouter un porche en tour, d’abord en bois, puis en pierre (1884), orné d’un crénelage. Ce porche donne à l’église un caractère fortifié, en écho aux anciennes églises anglaises.
Des éléments symboliques enrichissent l’édifice : une porte en chêne massif, une cloche, et une vitre-maîtresse du chevet offerts par une paroissienne fortunée, Miss Sheppard. C’est aussi à ce moment que des vitreries à treillis en verre translucide sont posées.
🧱 Maçonnerie et toiture (1889–2000)

En 1889, la maçonnerie de l’église est restaurée. Le toit initial en bardeau de cèdre est remplacé par de l’ardoise, matériau noble et durable, renforçant le caractère médiéval recherché. Il sera remplacé en 1966 par un toit en bardeau d’asphalte, puis restauré en ardoise en 2000.
🪵 Décoration intérieure (1896)
À la fin du XIXe siècle, l’intérieur est encore sobre. En 1896, l’église est entièrement lambrissée de frêne, bois local. Les planches sont posées dans différentes directions : voûte en horizontal, cimaise en diagonale, murs en vertical. Cela réchauffe l’espace tout en respectant la vérité du matériau, valeur protestante fondamentale.
On installe aussi un nouveau système de chauffage à air chaud, et un nouvel autel est acquis. Cette campagne marque une étape essentielle dans l’embellissement intérieur de l’église.
✨ Mobilier liturgique (1896–1940)
Le style néogothique est interprété avec une richesse décorative notable :
- Arcs ogivaux et trilobés dans la nef.
- Détails gothiques dans les meubles : gâbles, pinacles, roses, rosettes, oculus.
- Mobilier liturgique sculpté (chaire, trône, crédence, lutrin), réalisé entre 1896 et 1940.
- Usage de lettres onciales et de motifs naturalistes (feuilles de lierre).
En 1944, une nouvelle porte est conçue dans un style « nouveau gothique », inspiré par l’architecte Dom Bellot. Son arc en mitre rappelle les expériences modernes du gothique. En 2000, cette porte est déplacée à l’intérieur du portique, retrouvant les proportions d’origine de l’entrée.
🕯️ Premiers vitraux commémoratifs (1855–1863)
Avant l’incendie de 1863, deux vitraux importants sont installés :
- Un mémorial dédié au révérend G.M. Ross, pasteur de la paroisse pendant 28 ans, placé dans le chœur.
- Un second en mémoire du major Menzies et de son épouse, offert par leur fille et placé dans la nef.
Ces deux vitraux sont rescapés de l’incendie et réinstallés dans les baies du mur sud de l’église.
⏳ Vitraux temporaires (1866)
Après la reconstruction, les fenêtres sont garnies de vitreries à treillis en verre translucide. Cette solution, peu coûteuse, est encouragée par l’évêque Mountain. Elle permet d’attendre les dons futurs sous forme de vitraux commémoratifs, devenu populaires dans les églises anglicanes du Québec après 1850.
🕊️ War Memorial (vers 1947)
Un nouveau vitrail commémoratif est installé vers 1947. Il rend hommage à six paroissiens morts durant les deux guerres mondiales. Ce vitrail s’ajoute aux précédents sur le mur sud, renforçant l’aspect mémoriel de cette paroi. Conçu et réalisé par l’Atelier Robert McCausland Limited de Toronto, l’un des rares ateliers encore en fonction.
🎨 L’influence du vitrail « archéologique »
Les vitraux de Saint George, produits par la maison montréalaise J.C. Spence, s’inscrivent dans l’esthétique du vitrail dit « archéologique », un style historiciste typique du XIXe siècle. Chez les anglo-protestant. Cette approche privilégie une forte cohérence décorative, sans recourir à la figuration humaine, longtemps évitée dans les milieux protestants. Les caractéristiques dominantes incluent :
- Verres colorés aux tons saturés et contrastés
- Bordures larges, treillis rectilignes
- Médaillons, quadrilobes, encadrements soulignés par des galons
- Fonds décoratifs damassés ou en « cage à mouches »
- Usage de la grisaille pour le dessin des motifs
Ces éléments donnent une unité stylistique forte à l’ensemble. La vitre-maîtresse du chevet, les mémoriaux Ross et Menzies ainsi que la vitrerie de la nef illustrent parfaitement cette signature.
💠 John C. Spence et son héritage
John C. Spence (1830-1890), originaire du Royaume-Uni, s’installe à Montréal en 1855. Dès 1858, il est répertorié dans l’annuaire Lovell comme « peintre décorateur » et fabricant de vitraux pour églises, édifices publics et bateaux à vapeur. En 1872, il fonde la Stained Glass Works, qui devient en 1882 la J.C. Spence & Sons. Ses fils prennent la relève en 1894, ajoutant la vente d’objets et de mobilier religieux. L’entreprise cesse ses activités en 1920.
La maison Spence a surtout produit pour les communautés anglophones, en particulier l’Église d’Angleterre. Les vitraux de Saint George trouvent ainsi des équivalents stylistiques à Christ Church de Sorel, Saint Mary de Hudson et Holy Trinity du Lac-Brome, tous exécutés avant les années 1870. Par la suite, un changement de mentalité s’opère, ouvrant la voie à l’insertion des vitraux historiés dans les lieux de culte.
🔣 Symbolisme et versets bibliques
Le langage symbolique est préféré à la narration figurée. On trouve des motifs comme la colombe, le lierre, le chrisme ou la croix pattée, plutôt que des scènes bibliques. Cette réserve face à l’image est typique du protestantisme anglican du XIXe siècle.
Ce n’est qu’à partir de 1864 que le vitrail historié, représentant des scènes bibliques, est accepté dans les églises anglicanes, avec la pose d’un triptyque à la cathédrale Holy Trinity de Québec. Mais à Saint George, cette évolution reste mesurée au moyen financier des paroissiens.
Des extraits des Saintes Écritures viennent parfois enrichir le langage visuel des vitraux. À la base de la vitre-maîtresse offerte par Miss Sheppard, on peut lire le répons « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », tiré de l’évangile selon saint Luc. Dans les vitraux commémoratifs, les versets sont empruntés à l’Apocalypse de saint Jean, comme la citation « Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur », visible dans les phylactères des mémoriaux Ross et Menzies. Pour le vitrail dédié aux soldats tombés au combat, le verset « Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne de vie » résonne comme un hommage au sacrifice héroïque, alliant foi, mémoire et espoir d’éternité.
🔄 Continuité et renouvellement stylistique
Un siècle plus tard, des motifs comme le lierre sont réutilisés dans les ornements métalliques de la clôture du sanctuaire. Cette persistance iconographique montre la volonté de continuité esthétique.
Le style évolue lentement, intégrant parfois des touches plus modernes, comme dans la porte de 1944, mais toujours en restant fidèle à l’esprit néogothique et à l’équilibre entre décor et sobriété, caractéristique de l’esthétique anglicane.
En 1948, un vitrail commémoratif, le War Memorial, trouve naturellement sa place dans la nef. Il représente saint George agenouillé devant le « Prince de la Paix ». Cette œuvre, réalisée dans un atelier de Toronto soit l’atelier ROBERT Mc Causland Limited est attribuable à un vitrailliste formé en Angleterre, comme en témoignent plusieurs caractéristiques propres au style Arts & Crafts : l’utilisation de paysages en arrière-plan comme écrans visuels, le choix particulier de forme et de taille des verres pour représenter le ciel, l’absence de carnation sur les visages – taillés dans du verre blanc et peints uniquement à la grisaille –, ainsi que la représentation d’un Christ filiforme. Ce vitrail illustre une synthèse d’influences esthétiques britanniques et nord-américaines.
⛪ les vitraux: mémoire et symbolisme en lumière

Dans la tradition médiévale, les vitraux ont longtemps été exclus des lieux de culte. Mais à partir des années 1840, cette tendance évolue. L’Église Saint George suit ce renouveau avec la pose de ses premières verrières commémoratives.
Deux vitraux, installés avant l’incendie de 1863, sont parmi les plus anciens : l’un en mémoire du révérend G.M. Ross, pasteur de 1827 à 1855, placé dans le choeur et offert par les paroissiens ; l’autre dédié au major Menzies et à son épouse Helen Steward, offert par leur fille et installé dans la nef. Ces deux pièces survivent à l’incendie et retrouvent leur place dans les baies sud de l’église.
Les vitraux qui habillent ensuite les fenêtres de la nef dans les décennies suivantes suivent une esthétique bien particulière : celle du vitrail archéologique,(excepté le War Memoria) tel que popularisé par l’atelier montréalais J.C. Spence. On y retrouve des verres saturés, contrastés, des bordures épaisses, treillis rectilignes, médaillons, quadrilobes, jeux de fond damassés ou « cages à mouches », le tout dessiné à la grisaille.
Le choix de symboles — plutôt que de figures humaines — témoigne d’une pudeur protestante face à la représentation imagée. La feuille de lierre, notamment, revient fréquemment comme motif décoratif, traversant les décennies : présente dans les vitraux des années 1850, elle est reprise plus de cent ans plus tard dans la clôture du sanctuaire.
Enfin, en 1947, un vitrail War Memorial est ajouté, en hommage aux six paroissiens tombés lors des deux guerres mondiales. Ce dernier complète un ensemble cohérent et évocateur, où chaque verrière raconte une histoire, honore une mémoire, et prolonge la spiritualité du lieu dans la lumière colorée.
📘CONCLUSION
L’église Saint George est un remarquable exemple de transposition du modèle médiéval anglais dans un contexte québécois rural du XIXe siècle. Grâce à une architecture rigoureuse, un mobilier harmonisé et des vitraux d’un grand raffinement symbolique, elle reflète les idéaux liturgiques et esthétiques de l’anglicanisme de l’époque. Le parcours de ses vitraux, entre mémorial, décoration et affirmation identitaire, témoigne d’un usage réfléchi de l’image dans le cadre protestant, où mémoire et modération priment sur la profusion figurative.
DESCRIPTIONS DES VITRAUX
Mémorial du Révérend G. M. L. Ross

📍 Localisation : Mur sud du chœur
📅 Date : 1855
🎨 Auteur : J.C. Spence, Montréal (non signé)
📏 Dimensions : 194 cm x 72 cm
🧪 Matériaux : Verre antique et verre cathédrale, plomb, grisaille
🛠 Statut :
- Sauvé de l’incendie
- Réinstallé vers 1865
- Restauré en 1931 (?)
- Restauré en 1996 par Richard Goldfinch (Lennoxville)
🛠 Remarques de restauration :
- Inscription refaite
- Remplacement de plusieurs verres peints à la grisaille (dont le quadrilobe avec le IHS)
- Sigle christique remis à l’endroit
- Remplacement probable du verre cathédrale rouge central
🖼 Description :
Vitrail composé de deux lancettes surmontées d’un oculus, dans une fenêtre ogivale profonde.
Présence d’un Arbre de Vie central dans chaque lancette, entouré de phylactères avec les inscriptions :
Gauche : « I am the resurrection and the life » (Jean 11,25)
Droite : « Blessed are the dead which die in the Lord » (Apocalypse 14,13)
Quadrilobes à pointe :
Inférieurs : IHS
Supérieurs : couronne d’épines / croix et couronne royale
Épitaphe en bordure inférieure :
« In Memory of the Revd. G. Ross / Died 2th (?) August 1855 / Aged 51 years / 30 Years rector of this Parish. »
Grisaille dans l’oculus
🎨 Style archéologique :
- Bordure large
- Tableautins (quadrilobes à pointe) encadrés de galons
- Couleurs saturées et contrastées (bleu/rouge)
- Multiplication de motifs : croix de Malte, entrelacs, fleurettes
- Usage abondant de la grisaille et du jaune d’argent
🧠 Iconographie :
- Arbre de Vie : feuillage de lierre (symbole de mort et immortalité, style naturaliste anglais)
- IHS entrelacé : abréviation de Jésus Sauveur des Hommes
- Couronne d’épines : Passion et Rédemption
- Croix et couronne royale : Mort et Résurrection
Symbolique cohérente pour un mémorial pastoral, probablement financé par la communauté
Œuvre apparentée : Vitrail à Christ Church de Sorel
Sources :
Ferguson, Signs & Symbols in Christian Art, Oxford University Press, p. 33
Owen Jones, The Grammar of Ornament, 1re éd. anglaise : 1856
Mémorial des époux Menzies
📍 Localisation : Nef sud
📅 Date : 1857
🎨 Auteur : J.C. Spence, Montréal (non signé)
📏 Dimensions : 229 cm x 87 cm
🧪 Matériaux : Verre antique, plomb, grisaille, jaune d’argent
🛠 Statut :
- Sauvé de l’incendie
- Réinstallé vers 1865
- Restauré en 1949
- Restauré en 1998 par Richard Goldfinch
🎁 Donatrice : Leur fille
🖼 Description :
Double lancette surmontée d’un oculus dans une fenêtre ogivale profonde.
Végétal de type renoncule autour duquel s’enroulent deux phylactères avec inscriptions :
Gauche : « Blessed are the dead which die in the Lord » (Apocalypse 14,13)
Droite : « Even so saith the Spirit for they rest from their labours » (Apocalypse 14,13)
Six médaillons historiés entre les feuilles :
4 évangélistes (symboles zoomorphes d’Ézéchiel et l’Apocalypse)
2 symboles funéraires (serpent avec sablier, couronne avec flambeau éteint)
Oculus : rose quadrilobée avec monogramme IHS
Épitaphe en bordure inférieure :
Gauche : « To the Church of God from / A Daughter in Memory / of her beloved Parents »
Droite : « Major Menzies Died 9th Feb / 1853 Aged 71 Years & Helen / Stewart Died (…) Janv 1857 »
🎨 Style archéologique :
- Bordure large
- Médaillons soulignés par galons perlés
- Couleurs saturées et contrastées :
- Fond damassé: bleu pour les médaillons, rouge pour celui de l’arbre qui reprend le motif de la vigne-lierre
- Alternance de motifs phytomorphes (chardon ?)
- Usage ample de la grisaille et du jaune d’argent
🧠 Iconographie :

- Les 4 médaillons évangélistes :
- Lion (Marc) : Résurrection / Royauté
- Aigle (Jean) : Nature divine du Christ
- Taureau (Luc) : Sacrifice / Sacerdoce
- Ange (Matthieu) : Enfance du Christ
- Symboles funéraires inspirés du XVIIIe siècle :
- Serpent mordant sa queue : mort / résurrection
- Sablier : temps, mort
- Couronne : victoire sur la mort
- Flambeau éteint : motif funéraire d’origine grecque
💬 Commentaire :
Vitrail plus élaboré que le mémorial du pasteur.
Coût probablement supérieur, pris en charge par la famille.
Œuvre apparentée : Vitrail à Christ Church de Sorel-Tracy
Sources :
Lewis, Philippa et Gillian Darley, A Dictionary of Ornament, Pantheon, 1985, p. 162, 296
🪟 Fiche vitrail
Vitre-maîtresse du chevet – Thème : Foi et pratique religieuse
📍 Localisation

Chevet plat orienté nord-est, église non spécifiée (à compléter selon le contexte).
🎁 Donateur
Offerte par Miss Sheppard à la suite de l’incendie de 1863.
🛠 Restaurations
- Vers 1931 (à confirmer)
- 1966, par Verrière & Co.
- 1996, par Richard Goldfinch
🧑🎨 Auteur
J.C. Spence, Montréal
Vitrail non signé, daté de 1866
📏 Dimensions
336 cm (hauteur) × 181 cm (largeur)
(Hauteur estimée par projection de la largeur mesurée)
🧪 Matériaux et techniques
- Verre antique
- Plomb
- Grisaille
- Jaune d’argent
🖼 Description formelle

Verrière composée de trois lancettes ogivales, celle du centre étant plus haute.
Sur un fond de treillis rectiligne en verre blanc peint à la grisaille, ponctué de motifs symboliques (IHS, feuilles de lierre, couronne traversée d’une rose sauvage), se détachent six médaillons colorés (répartition 1–4–1).
- Lancette gauche : un meuble liturgique (probablement une chaire à prêcher)
- Lancette droite : l’Agneau mystique debout tenant l’oriflamme
- Lancette centrale (du haut vers le bas) :
- Triangle rayonnant (Dieu le Père)
- Colombe en vol piqué (Saint-Esprit)
- Livre ouvert (La Sainte Bible / la Parole)
- Ancre, cœur et croix (les vertus théologales : Espérance, Charité, Foi)
Chaque lancette est bordée de verres colorés décorés de fleurettes alternant avec un motif d’arbuste à baies et de corps à écailles.
Une inscription court en bas du vitrail sur toute la largeur.
💬 Commentaire stylistique et iconographique
Ce vitrail illustre les principes du vitrail archéologique du XIXe siècle :
- Bordures larges
- Médaillons insérés dans des cadres soulignés
- Fonds rectilignes (losanges)
- Couleurs saturées
- Fonds damassés et riche décor périphérique
- Abondance de grisaille et touches de jaune d’argent
L’iconographie évoque clairement la Trinité et les vertus chrétiennes. L’association d’un livre identifié à la Bible et d’un meuble liturgique renforce l’idée d’une valorisation de la Parole, centrale dans les églises réformées.
L’absence du calice eucharistique invite à interpréter le meuble comme une chaire plutôt que des fonts baptismaux.
La configuration tripartite de la verrière et sa lumière traversante au moment de l’office correspondent pleinement à la symbolique néogothique victorienne, que Spence a su adapter pour les petites communautés protestantes, comme en témoignent des œuvres similaires à Hudson (Saint Mary, 1865) ou Lac-Brome (Holy Trinity, v.1865).
🕊️ War Memorial : le Chevalier saint Georges et le « Prince de la Paix »

📍 Emplacement : Mur sud de la nef, vers l’arrière de l’église
📜 Titre : War Memorial – Le Chevalier saint Georges et le « Prince de la Paix »
👤 Auteur : Anonyme (aucune signature relevée)
📅 Date : Vers 1948
🛠️ Restauration : 1996, par Richard Goldfinch
📏 Dimensions : 260 cm x 87 cm
🧪 Matériaux : Verre, plomb, grisaille
🖼️ DESCRIPTION

Ce vitrail commémoratif est composé de deux lancettes surmontées d’un oculus circulaire (tympan). Il représente une scène unique répartie sur les deux panneaux :
Saint Georges, figuré comme un jeune chevalier en armure, est agenouillé devant le Christ. Sa main droite est posée sur son cœur, la gauche serrant le pommeau d’une épée fichée dans le sol – geste de loyauté et d’abandon de la violence.
Le Christ, mince et drapé d’un manteau royal fastueusement orné, est debout face au chevalier. Il incarne ici le « Prince de la Paix », une figure royale et spirituelle inspirée du célèbre tableau The Light of the World de William Holman Hunt.
L’identification de saint Georges est rendue explicite par la croix rouge sur l’écu visible dans l’oculus. Dans la partie inférieure des lancettes se trouvent deux bandeaux portant une citation biblique ainsi que deux écus avec les noms des paroissiens morts lors des deux guerres mondiales. Ces écus reposent sur un fond de feuilles d’érable, symbole canadien.

✍️ INSCRIPTIONS
📖 Citation : Be Thou Faithful unto Death / And I will give Thee a crown of Life (Apocalypse 2:10)
🛡️ Écu gauche (1914–1918) : Forrest Mitchell / Walter M. Montgomery / Angus Warkins
🛡️ Écu droit (1939–1945) : James A. Fieldsend / Herbert G. C. Mitchell / Ernest Whittingham
🙏 Sous les écus : To the Glory of God and in Memory of the men of This Parish who died on active service. May God of his Mercy grant them Eternal Rest and Peace. Amen.
💬 COMMENTAIRE
Ce vitrail, conçu comme un vitrail-tableau, présente une iconographie symbolique privilégiant la représentation allégorique à la scène militaire explicite. Cette approche, typique des vitraux commémoratifs d’après-guerre, s’inscrit dans une tradition anglo-protestante de mise en scène du sacrifice et de la foi.
Plusieurs éléments suggèrent une exécution par un atelier canadien influencé par le style britannique :
- 🌄 Le paysage formant un écran derrière les figures
- 🎨 L’usage du verre blanc peint à la grisaille pour les visages
- 🧍♂️ L’aspect allongé du Christ
- 📚 La disposition narrative, rare mais évocatrice
L’atelier Robert McCausland Limited de Toronto, est l’auteurs. La figure du jeune chevalier évoque les héros vertueux de la littérature victorienne, soulignant ici le message de fidélité, de paix, et de rédemption.
Vitrerie de la nef

- 📍 Localisation : Nef de l’église – 8 fenêtres : 5 du côté nord, 3 du côté sud
- 🧑🎨 Auteur : J.C. Spence, Montréal
- 📅 Date : Vers 1865-1866 (reconstruction de l’église)
- 🔧 Consolidations ultérieures :
– Vers 1931 (?)
– En 1966 (probablement par Verrière & Co ou Verrière du Québec) - 📏 Dimensions : 260 cm x 87 cm (hauteur estimée par projection de la largeur mesurée)
- 🔹 Matériaux : Verre antique, plomb, grisaille
📜 Description :

Ensemble de huit verrières installées en alternance le long des murs de la nef. Chaque fenêtre est composée de deux lancettes surmontées d’un oculus, le tout inscrit dans une baie ogivale profonde, dont les boiseries font office de remplage.
Les verrières suivent une alternance de couleurs :
– Bordure rouge / oculus bleu
– Bordure bleue / oculus jaune
Les panneaux sont montés en treillis de losanges.
Les verres translucides sont peints à la grisaille, probablement au pochoir, et décorés de fleurs de lys et de couronnes traversées par une tige florale.
💬 Commentaire :
L’usage de verrières en verre translucide à motifs losangés est cohérent avec les recommandations de l’évêque Mountain, qui, dès 1851, privilégiait cette solution économique, en attendant la donation éventuelle de vitraux figuratifs.
Les motifs choisis revêtent une symbolique complexe :

– La fleur de lys, héritée de l’héraldique française, peut symboliser :
- 👑 La royauté
- ✝️ La Sainte Trinité (dans l’interprétation presbytérienne)
- 📖 L’enseignement religieux
- 🕊️ La piété et l’innocence (dans les contextes funéraires)
La couronne florale est également présente dans les motifs de la vitrail-maîtresse.
Ces ornements témoignent d’une inspiration décorative néogothique, probablement issue des planches de The Grammar of Ornament d’Owen Jones (1856).
Pout en savoir plus sur la restauration des vitraux, voici l’article
Note : Des outils d’intelligence artificielle ont contribué à la rédaction de ce texte. Cependant, son contenu a été révisé, modifié et validé par une maître historienne Mme Ginette Laroche et humblement par moi.